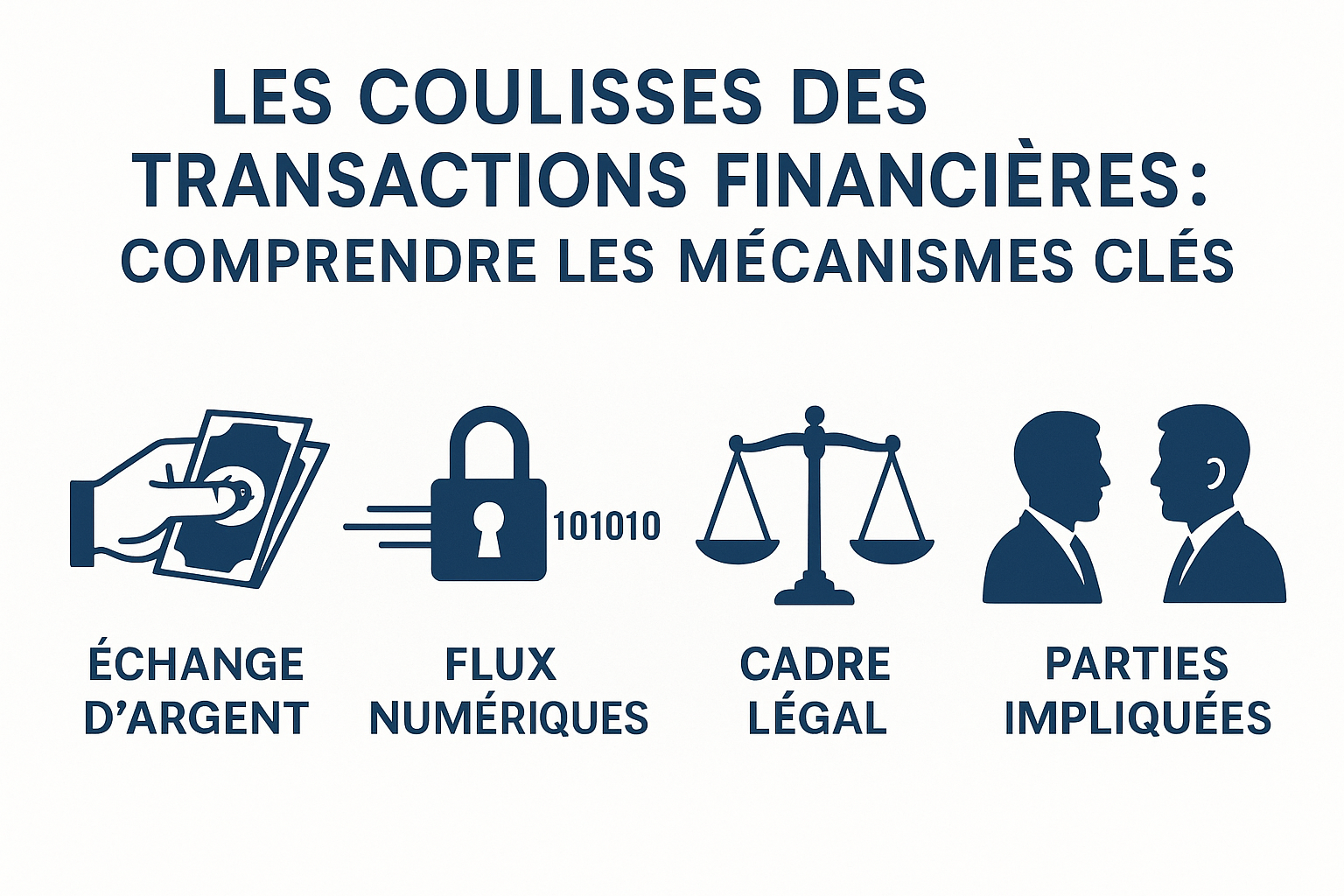Les opérations financières, qu’il s’agisse de prêts, de placements, de transferts ou de transactions de marché, reposent sur un ensemble de mécanismes fondamentaux. Ces derniers assurent la fluidité des échanges, la gestion des risques et la formation des prix dans un écosystème complexe d’acteurs et d’instruments. Cet article en présente les principaux, classés selon leur fonction et leur rôle dans le circuit financier.
1. L’intermédiation et la transformation financière :
Au cœur du système, les intermédiaires financiers (banques, assurances, fonds d’investissement, etc.) mettent en relation les agents à capacité de financement (ménages, entreprises) et ceux à besoin de financement. Ils opèrent trois grandes transformations :
- Transformation de l’échéance :
Les déposants peuvent retirer leurs fonds à court terme, tandis que les banques prêtent sur des horizons plus longs (prêts immobiliers, financements d’infrastructures). - Transformation de la liquidité :
Les actifs bancaires (crédits) sont moins liquides que les dépôts : les intermédiaires absorbent le risque de liquidité, en gérant leurs réserves et accès aux refinancements (marchés de gros, banques centrales). - Transformation du risque :
En mutualisant et diversifiant les actifs, les établissements réduisent le risque supporté individuellement par chaque épargnant.
2. La formation des prix et la découverte de l’information:
Sur les marchés (actions, obligations, devises, matières premières) et plateformes organisées :
- Carnets d’ordres et market makers :
Les cotations naissent de l’équilibre entre les ordres d’achat et de vente. Les market makers garantissent la liquidité en affichant des fourchettes de prix « bid/ask ». - Mécanismes d’enchères :
Sur certains segments (émissions obligataires, allocations d’actifs), les prix se déterminent via des enchères compétitives. - Rôle de l’information :
Chaque transaction véhicule une information sur la valeur perçue d’un actif. Les mécanismes de transparence (publication des volumes, des best bids/offers) sont cruciaux pour limiter l’asymétrie d’information et le risque d’adverse selection.
3. Compensation et règlement–livraison :
Après la négociation, deux étapes clés garantissent la finalité de l’échange :
- La compensation :
- Les chambres de compensation (CCP) centralisent les obligations des contreparties, effectuent le netting (compensation multilatérale) et calculent les marges à verser.
- Les chambres de compensation (CCP) centralisent les obligations des contreparties, effectuent le netting (compensation multilatérale) et calculent les marges à verser.
- Le règlement–livraison :
- Le système de paiement (RTGS, TARGET2 en zone euro) assure le transfert des fonds.
- Le système de livraison (ICSD, CSD) transfert la propriété des titres.
L’atomicité (paiement contre livraison) évite le risque de contrepartie : chaque partie ne transfère son engagement qu’une fois sûre de recevoir l’autre.
- Le système de paiement (RTGS, TARGET2 en zone euro) assure le transfert des fonds.
4. Gestion du risque et collatéralisation :
Pour maîtriser le risque de crédit et de marché :
- Appels de marge :
Les variations de valeur des positions (futures, options, dérivés de gré à gré) déclenchent des appels de marge (variation margin) pour ajuster les garanties. - Usage de collatéral :
Les titres de haute qualité (bons du Trésor, obligations d’État) servent de gage dans les opérations de pension livrée (repo) ou de dérivés. - Ratios prudentiels :
Bâle III impose des exigences de fonds propres selon le risque pondéré des actifs (RWA), incitant les banques à limiter leur levier.
5. Innovation financière et titrisation :
La titrisation transforme des actifs peu liquides (portefeuilles de prêts) en titres négociables, distribués à des investisseurs. Les étapes principales :
- Origination : constitution d’un pool d’actifs (crédits, créances).
- Special Purpose Vehicle (SPV) : entité ad hoc qui émet les titres.
- Tranching : structuration en tranches de risque et de rendement différenciés.
Bénéfices : transfert du risque hors bilan, diversification pour les investisseurs. Risques : complexité, opacité et effets de contagion (cf. crise de 2008).
6. Rôle des autorités de régulation et des infrastructures :
Pour garantir la stabilité du système :
- Banques centrales :
Fournissent les liquidités (prêts intrajournaliers, opérations d’open market), encaissent les risques de liquidité et agissent comme prêteur en dernier ressort. - Autorités de supervision (ACPR, ESMA…) :
Veillent à la résilience des établissements, à la transparence des marchés et au respect des règles prudentielles. - Infrastructures de marché (Euronext, LCH, CLS) :
Assurent la continuité des échanges, la résilience opérationnelle et appliquent des normes strictes de sécurité des données et de continuité des activités.
Conclusion :
Derrière chaque transaction financière se cache un maillage de mécanismes techniques et juridiques visant à transformer les caractéristiques des capitaux, à gérer les risques, à découvrir les prix et à garantir le règlement effectif. Mieux les comprendre, c’est appréhender les ressorts de la liquidité, de la stabilité et de l’efficacité du système financier global – autant de facteurs essentiels pour les professionnels comme pour les particuliers.